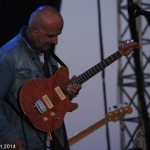« Depuis sa création, il y a près de trente ans, le festival apporte un soutien indéfectible au bouillonnement culturel de la Bretagne, loin des clichés poussiéreux et de la folklorisation au formol. Chaque année, les artistes soutenus par le festival sont les acteurs vivants d’une Bretagne contemporaine et innovante. A travers la musique, le chant, le théâtre, la danse ou encore la mode, s’expriment autant d’individus avec leurs identités, autant de façons de partager et de transmettre sa Bretagne aux autres, avec ses métissages, ses rencontres…
A l’heure de la culture de masse et de la mondialisation décomplexée, il revendique ses singularités. Fier de son identité bretonne, il n’en est pas moins ouvert sur le monde et sur la diversité culturelle.
Jean-Michel Le Boulanger dans son livre « Être breton ? » aux éditions Palantines l’exprime parfaitement: « Oui aujourd’hui, nous pouvons nous dire, nous revendiquer, nous affirmer bretons, sans en maîtriser la langue, sans en écouter la musique, sans en fréquenter les festoù-noz… Seulement voilà : la langue, la musique et le fest-noz existent. S’ils disparaissaient, pourrions-nous continuer à être bretons ? »
(extrait du site officiel du festival)
Le son de la bombarde et du biniou s’échappe dans la nuit, sur scène des acteurs jouent une pièce en breton, dans le port les vieux gréements montrent leurs plus beaux atours, sur le pont, on y danse, on y danse… Le festival Kann Al Loar revient, chaque mois de juillet, attirant chaque année depuis quinze ans des milliers de personnes, touristes de passage ou habitants de la Bretagne… 40 000 spectateurs en 2001 ! que de chemin parcouru depuis sa création en 1987 ! En fait, tout en évoluant chaque année, le Festival est depuis ses débuts fidèle à ses trois axes conducteurs :
.Tout d’abord, il aborde la culture bretonne vivante sous toutes ses facettes, dans sa richesse et sa diversité : qu’il s’agisse de la musique, de la musique traditionnelle au rock celtique, en passant par le chant choral, qu’il s’agisse de la danse, traditionnelle, avec notamment le Concours de Danse Kef, ou contemporaine d’inspiration celtique, ou de chorégraphies modernes basées sur la tradition, avec notamment le Festival du Léon, qu’il s’agisse du théâtre en langue bretonne, de la culture de la mer avec sa Fête du Patrimoine Maritime où les vieux gréments rejoignent les métiers de la mer, qu’il s’agisse de l’artisanat d’art, de la gastronomie bretonne, des jeux et sports traditionnels bretons avec son Village en Fête, de la littérature avec sa Rencontre des Editeurs et des Ecrivains Bretons.
Kann Al Loar est ainsi le Festival par excellence de la création théâtrale en langue bretonne. En effet, tous les ans, c’est à Kann Al Loar que sont jouées en première les nouvelles pièces de théâtre en breton.
Un autre exemple est le chant choral breton, qui a vu, depuis ces quatorze dernières années, ses plus importantes oeuvres créées lors du Festival Kann Al Loar : citons War varc’h d’ar mor, Kan evit ar Peoc’h, Ar Basion Vras, Buhez, Droug-kinnig Nevenoe, Missa Armorica… Même les sons et lumières d’Ar Vro Bagan ont été créés à Kann Al Loar : Ys la maudite, Liberta, La Passion Celtique, 39-45, Tristan et Yseult.